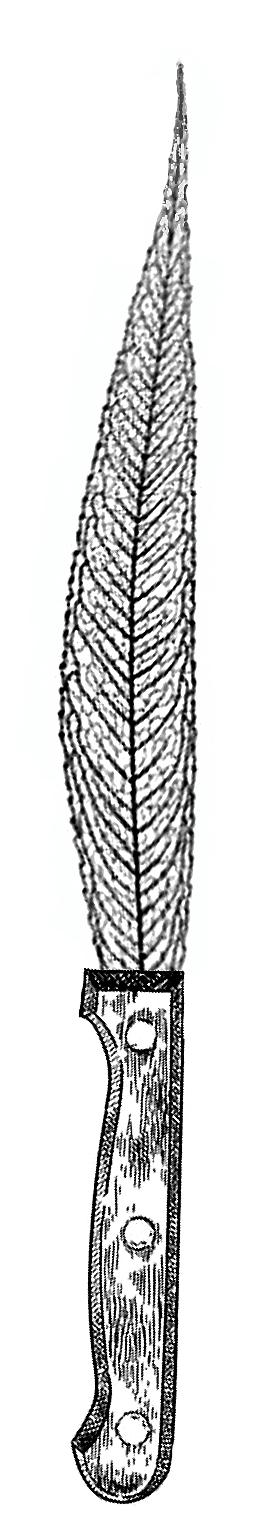Je pourrait affabuler, faire ma fière et déclarer avec un sourire satisfait que ce que j’ai fait je l’ait fait sans jamais hésiter, que la peur ne m’a jamais tiraillé mais ce serait mentir. Et en cette heure qui sonne comme ma dernière, je pense que je vous dois la vérité, la mienne en tout cas, celle des souvenirs que l’on brode au continue du fil de notre existence.
Je suis née dans une immense plaine agricole, de ces territoires à la géographie maîtrisée, à la nature étouffée. Je n’ai pas connu les guets mais les ponts, les jachères à la place des friches. Moi qui rêvait de rivière, de fleuve devait me contenter des canaux d’irrigation. Je m’endormais dans la civilisation et espérais me réveiller dans le sauvage, dans une préhistoire fantasmée, un monde qui m’aurait broyée encore plus sûrement que celui-là.
Si mon premier départ eu lieu avec l’internat, ce n’est qu’à la fin du lycée que je partis réellement. Je n’ait pas de réelle souvenir de la faculté, ce fut une période studieuse entrecoupée du plaisir charnel que trouvent les âmes déracinés quand elles se rencontrent.
La société avait fini par me trouver une place, un petit pot de 9h a 17h où je pourrais m’épanouir. Moi qui espérais un bocage redevenu sauvage, je me retrouvais enfermée dans une serre. Maintenant que je fais le bilan du passé, qu’à la lumière dérisoire des allumettes de la vieillesse j’explore les boyaux sombres de mes actions, c’est peut-être là que j’ai enterré mes illusions. Mais j’y voyais des graines, des arbres qui fendraient le béton, des herbes qui descelleraient le pavé. A défaut d’apporter la nature à la ville, j’avais changé le décor de mes songes.
Du spectacle désolant de la société contemporaine, j’ai voulu cesser d’être spectatrice. Quitter le public pour improviser, a la manière de ces enfants patauds qui une fois sur scène se rendent compte qu’ils n’ont rien à déclamer. Qu’importe puisque finalement, ce n’est pas les regards de la salle qui nous poussent, pas plus que la chaleur des projecteurs ne nous conduisent à y rester. L’envie qui m’a prise et qui aujourd’hui encore m’attire n’est pas celle du jugement ou de la célébrité, c’est une impulsion pour soi, une déclaration d’amour personnel. Je ne voulais plus jouer les médiatrices de mes propres désirs mais les accepter, les vivre. Toucher le présent comme on se caresse le corps.
La désertion m’apparaît aujourd’hui encore comme le plus beau des gestes, un refus si simple, si élégant. A vivre dans des casernes on finit par oublier qu’il existe un monde derrière les murs, qu’il y a de la poésie derrière les ordres, des corps nus sous les uniformes.
Maintenant que je viens chercher la mort, je me suis jamais sentie autant en sécurité. Quelque chose que j’ai fuit durant toute ma cavale et que j’accueille maintenant avec soulagement. Peut-être parce que malgré mes yeux qui me trahissent je vois frémir la végétation sous le bitume. Peut-être qu’au dernier acte de ma vie je comprend que ceux qui ne sont pas jugés par les tribunaux seront jugés par l’histoire.