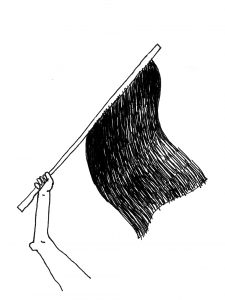Lucy Parsons (1851-1942) s’est battue toute sa vie pour la liberté, que ce soit par ses écrits dans The Alarm ou The Liberator, mais aussi en fondant l’Industrial Workers of the World (IWW), un des plus grand syndicat états-uniens de la fin du XIXe siècle. Dans ce texte de 1886, elle prend la défense des anarchistes de Chicago condamnés à mort suite à l’affaire de Haymarket Square. Parmis eux, son époux Albert Parsons.
Vous demandez-vous pourquoi il y a des anarchistes dans ce pays, dans cette grande terre de liberté, comme vous aimez l’appeler ? Allez donc à New York. […] Faites le compte des myriades d’affamés ; du nombre croissant des milliers de sans-logis ; comptez donc tous ceux qui travaillent plus dur que des esclaves et vivent de moins encore, avec moins de confort que les esclaves les plus démunis. […] Ils ne sont pas objets de charité, ils sont les victimes de l’injustice flagrante qui imprègne le système de gouvernement, et de l’économie politique qui prédomine de l’Atlantique au Pacifique.
[…]
Vous avez entendu parler d’un certain rassemblement d’Haymarket. Vous avez entendu parler d’une bombe. Vous avez entendu parler d’arrestations et d’arrestations suivantes par des inspecteurs.
[…] Les bombes de dynamite peuvent tuer, peuvent assassiner, comme le peuvent les mitrailleuses Gatling. Supposez que la bombe ait été lancée par un anarchiste. Le rassemblement d’Haymarket Square était un rassemblement pacifique. Supposez, lorsqu’un anarchiste a vu les policiers arriver sur place, avec le meurtre dans leurs yeux, déterminés à briser ce rassemblement, supposez qu’il ait lancé cette bombe ; il n’aurait enfreint aucune loi. Voilà ce que serait le verdict de vos enfants. Si j’avais été présente, si j’avais vu ces policiers assassins s’approcher, si j’avais entendu cet ordre insolent de dispersion, si j’avais entendu Fielden dire « Capitaine, c’est un rassemblement pacifique », si j’avais vu les libertés de mes concitoyens foulées aux pieds, j’aurais jeté cette bombe moi-même. … Je méprise le meurtre. Mais lorsqu’une balle de revolver d’un policier tue, il s’agit bien plus d’un meurtre que lorsque la mort résulte de l’explosion d’une bombe.
[…]
La découverte de la dynamite et son utilisation par des anarchistes est une répétition de l’histoire. Quand la poudre fut découverte, le système féodal était au faîte de sa puissance. Sa découverte et son usage engendrèrent les classes moyennes. Sa première détonation sonna le glas du système féodal. La bombe de Chicago a sonné la chute du système salarial du dix-neuvième siècle. Pourquoi ? Parce que je sais qu’à l’avenir plus aucune personne intelligente ne se soumettra au despotisme. Elle signifie la dispersion du pouvoir. Je ne dis à personne d’en user. Mais ce fut une réalisation de la science, non de l’anarchie, faite pour les masses. […]
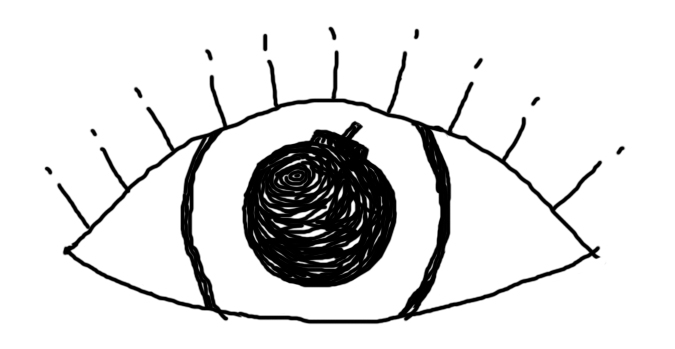
Il fut démontré au procès que le rassemblement d’Haymarket n’était le résultat d’aucun complot, mais advint de la façon suivante. La veille du jour où les esclaves salariés de l’usine McCormick firent grève pour la journée de travail de huit heures, McCormick, de son luxueux bureau, d’un seul coup de crayon tenu par ses doigts oisifs et ornés de bagues, avait privé 4.000 hommes de leurs emplois. Certains se sont réunis et ont bloqué l’usine. … Les policiers furent envoyés et ils tuèrent six esclaves salariés. Et cela, vous ne le saviez pas. La presse capitaliste passa cela sous silence, mais elle fit grand bruit de la mort de quelques policiers. Alors ces fous d’anarchistes, c’est ainsi qu’ils furent appelés, pensèrent qu’un rassemblement devrait être tenu pour réfléchir sur le meurtre des six camarades et discuter du mouvement des huit heures. Le rassemblement se tint. Il était pacifique. Quand Bonfield ordonna à la police de charger ces pacifiques anarchistes, quand il hissa le drapeau américain, il aurait dû être flingué sur le champ.
[…]
Laissez les enfants des travailleurs placer des lauriers sur le front de ces héros modernes, parce qu’ils n’ont commis aucun crime. Brisez le double joug. Le pain c’est la liberté et la liberté c’est le pain.