Sommaire :
–Les pieds dans le guidon
–Libérer pour partager
–Le cout de la vie
–Le placard
–Des médias dépendants
–Pensée anarchiste : Leur paix
–Contre l’école
–C’est reparti pour un tour
–Autour des violences sexuelles
–Lic’lance Libre

Le texte et les brochures qui suivent parlent de sexualités et d’agression. Ce sont des sujets qui remuent, donc faites attention à vous avant.
Le système patriarcal ce n’est pas seulement des individus de pouvoir et des institutions qui perpétuent la domination masculine, c’est un véritable poison qui vient pourrir jusqu’à nos interactions quotidiennes. Lutter contre les violences sexuelles, c’est aussi bien déconstruire toutes ces pressions qui nous font accepter et tolérer l’inacceptable qu’apprendre à régler nos comptes. La culture du viol n’est pas le privilège de quelques ordures mais une culture dans laquelle nous baignons toustes. Il faut détruire un ensemble de mentalité, d’institution et d’individu qui l’entretiennent et en tirent profit.
Une étape indispensable est de comprendre les jeux de pouvoirs et de manipulations au sein de nos relations. Démasquer les pressions que l’on se met nous-mêmes, révéler les manipulations et violences qui conduisent à ce qu’une relation désirée entre des personnes ne se transforme pas en un asservissement aux désirs d’une seule ou à ceux que nous impose la société. Il s’agit aussi de détruir les représentations de la sexualité véhiculées autour de nous et de les remplacer par ce que nous désirons.
Pour continuer cette réflexion, nous vous conseillons les articles du blog antisexisme.net sur les « interactions sexuelles à coercition graduelle »

Entre les interactions librement consenties et celles qui sont qualifiées de violences sexuelles, il existe toute une gamme d’interactions qui dépassent nos limites à des degrés divers. Ces dépassements ne sont pas forcément considérés comme des violences, que ce soit par la personne qui les dépassent ou la personne dont les limites sont dépassée. Cela est liée au fait que nos représentations des violences sexuelles sont si dramatiques qu’elles conduisent à dissimuler un nombre d’actions qui nous posent probleme à divers degrés. Nous nous retrouvons privé.es de terme pour définir de manière appropriée ce que nous avons vécu.es.
C’est ce sujet qu’approfondis la brochure Nous sommes touTEs des survivanTEs, nous sommes touTEs des agresseurSE.
Mais une fois que nous avons identifié un comportement problématique, réussi à mettre des mots sur nos expériences et nos ressenties, que faire ? Surtout comment faire lorsque l’on refuse de participer au jeux des tribunaux et de l’Etat ? Pas une réponse unique mais une multitude de possibilités, de propositions qui peuvent se succéder comme se combiner. Cela peut aussi bien passer par des processus de responsabilisation et transformation des personnes qui ont blessés, que par l’exclusion ou autres. Cela peut aussi être une remise en question des comportements et normes sociales qui servent de terreau à ces agressions (par exemple certaines manifestations de la culture du viol ou des éléments de la culture de l’intoxication), la mise en place de groupes en non-mixité… Mais aussi en élargissant la question aux réflexions concernant la gestion des conflits de manière plus générale.
C’est sur cet ensemble de perspectives que des compas nord-américain livrent un retour critique dans Accounting for ourselves. En quelques pages sont évoquées les limites de ces méthodes ainsi que des idées pour les dépasser.
Parce que sur le sujet des violences sexuelles, un des éléments importants est d’aider aux bien-être des personnes concernées, nous ne pouvons que très fortement vous conseiller la lecture de la brochure Soutenir un-e survivant-e d’agression sexuelle.

En ce mois de septembre, nous avons décidé de vous présenter deux brochures critiquant de manière radicale les bagnes scolaires et le monde auxquels ils préparent. À un moment où les discussions autour de l’éducation semblent se limiter à dénoncer la privatisation, il nous paraît important de proposer une critique plus profonde de ce qu’est l’école.
En quelques pages et quelques histoires, ces brochures brossent un panorama des reproches que l’on peut faire à l’école mais ouvre aussi des pistes vers d’autres possibilités, d’autres chemins.
Brûle ton école
Des petits contes pour brûler son école.
« Puis un animal fier de lui-même, appelé homo-sapiens tomba d’un arbre et déclara un jour :« ça y est je sais tout ! et je le sais mieux que tout le monde ! »
Et il se nomma lui même « Grand Maître d’Ecole »
Il découpa toute sa science en petit morceau et se mit à faire la leçon en distribuant de ces petits morceaux de savoir à qui voulait l’entendre.
Or, il se trouva que personne ne voulait l’entendre. »
On voudrait nous apprendre à marcher en nous coupant les pieds
« Ce monde, c’est de la merde. C’est pas la première ni la dernière fois qu’on le dira. A bas l’Etat, le travail, le citoyennisme, le spectacle, l’abrutissement de masse, la vigilisation des espaces et des esprits, l’uniformisation de tout, des comportements, des relations, les enfermements, la généralisation des moyens de contrôle, de surveillance, de répression (etc., etc.). Si on en est là, c’est qu’existe, parmi tant d’autres horreurs étatiques, l’ECOLE, l’éducation nationale, l’institution scolaire. L’école, avec la famille, le ciment de notre meilleur des mondes. »
Victor Serge (1880-1947) est un révolutionnaire belge. Il se rapproche des anarchistes-individualistes, rejette ce qu’il nomme les « absurdités syndicalistes » et défend des idées farouchement antimilitaristes. Il publie le texte Leur paix dans la revue L’anarchie N°313, le 6 avril 1911, dans un contexte de fortes tensions militaires et coloniales entre les états européens.
L’hypothèse de la guerre préoccupe en ce moment les esprits. Déjà l’on évoque l’horreur des champs de bataille, les villages incendiés, les cadavres semés au long des routes, les régiments décimés, et dans les villes restées paisibles l’angoisse et la faim… A s’imaginer que le renouvellement de ces spectacles est possible, le vulgaire reste déconcerté et stupéfié. La guerre est belle, dans les contes […] et les romans […]; la guerre est glorieuse dans les manuels d’histoire ; en réalité elle est horrible et chacun le pressent. Les plus veules, en y songeant, se hâtent de proclamer leur amour pour la paix… […]
Au fond du pacifisme il n’y a ni volonté ni intelligence ; il n’y a que de la peur et de l’hypocrisie. Les sincères ont peur. Les autres, n’ayant d’autre souci que celui de leurs intérêts, le servent sans scrupule. Il nous est ainsi donné de contempler ce tableau paradoxal : tandis que se tiennent des congrès de la paix, leurs initiateurs font construire des cuirassés… […]
Est-elle vraiment si belle cette paix, leur paix ?
Nous en jouissons pour le moment. Nous pouvons donc l’examiner à loisir, l’apprécier, la savourer. […] La Paix, sur les images, est une belle fille blonde au visage souriant, un peu bébête ? On n’a garde de représenter derrière elle les Casernes, les Prisons, les Hôpitaux et les Maisons Closes qu’elle abrite.
Leur Paix !
Mais c’est l’ordre, l’ordre sanglant que Thiers réinstaura en fusillant les fédérés de la commune, et que Clemenceau maintint avec le concours précieux des cuirassiers de Narbonne et les gendarmes de Draveil. La Paix bourgeoise exige que l’on respecte les lois établies, que l’on subisse la faim et l’oppression ; et quand on transgresse ses volontés, elle ramène l’ordre à coups de knout, à coups de sabres et de fusils… La paix sociale fait condamner les ouvriers pour un mot ou un geste d’insoumission ; emprisonner les journalistes trop indépendants ; traquer sans répit les indociles et les réfractaires. Sous les balles pacifistes, des prolétaires sont tombés bien des fois. Et Ferrer. Et que de nôtres, en Russie ou au Japon, sont morts sur les potences pacifistes !
Cela s’appelle l’ordre « moral » ou politique. […]
Ah, nos excellents pacifistes ne manquent pas de toupet lorsqu’ils dressent sous nos yeux l’épouvantable bilan des guerres. Celles de Napoléon, enseignent-ils, coûta à l’Europe cinq millions de vies humaines. Nous voudrions bien savoir, nous, combien de vies sont sacrifiées tous les jours à leur paix ?
Qu’ils nous disent combien d’enfants sont tués dans les verreries et les tissages du Nord ? Combien d’ouvriers meurent assassinés par les maladies professionnelles, les privations – la misère ? Qu’ils essayent de nous dresser le bilan approximatif des bonheurs, des vies, des joies pacifiquement broyées par l’engrenage des institutions du Capitalisme Autoritaire !
Nous désirons juger leur paix en connaissance de cause !
Leur paix est meurtrière autant que les guerres. C’est une paix de mort. Il a fallu autant de sang et de sueurs, autant de chair humaine pour édifier les fortunes des Rotschild, des Bunau Varilla, des Pereire et Cie, que pour constituer les empires des conquérants les plus fous. […]
La guerre, choc des armées, assassinat en masse évident et brutal, est pire, sans doute ; mais la paix d’aujourd’hui est ignoble, absurde et criminelle.
Nous nous refusons à la guerre, parce que nous aimons profondément la vie.
Et c’est en son nom – et au nom de nos vie tout d’abord ! – que nous nous insurgeons contre le règne de l’hypocrisie pacifiste et de la brutalité guerrière. Nos existences seraient si belles n’était-ce la malfaisante sottise des dominateurs et des asservis !
C’est donc malgré eux que dès à présent nous voulons réaliser des vies belles. Que vers ce but tendent nos efforts de révoltés : vivre selon nos pensées, librement, intelligemment, fraternellement : parmi nous du moins, instaurer une paix véritable qui nous rendra plus forts et plus heureux.

Suite à l’assassinat de Georges Floyd aux Etats-Unis et aux manifestations contre les violences policières appelés notamment par le comité Adama, cette question des violences policières refait son apparition dans les médias en France au mois de juin. Tout le monde en parle, et des expressions comme « violence systémique » et « racisme structurel » pour qualifier les keufs existent dans les médias.
Mais cela ne dure pas. Début juillet, Darmanin devient ministre de l’intérieur et reprend la défense aveugle des bleus, tout en parlant « d’ensauvagement », terme piqué à l’extrême droite, pour remettre en avant la fable de l’insécurité galopante. Et les journalistes suivent. Alors qu’en juin, des habitant·es racisé·es des quartiers populaires interviewés demandent justice, un mois plus tard d’autres demandent plus de police. L’ordre est rétabli.
Mais comment passe-t-on, en quelques jours, d’une situation médiatique à son contraire ? Rapide analyse et critique des médias en France.
Le secteur de la presse est dans les mains des plus riches et des plus puissants. Selon des chiffres de 2017 publié par bastamag1, huit milliardaires et deux millionnaires se partagent les principaux médias, qui représentent 90 % des quotidiens nationaux vendus chaque jour, 55 % des parts d’audience télé et 40 % de celles des radios. Parmi eux citons Bernard Arnault, à la tête du groupe de luxe LVMH, et patron des Echos et du Parisien, Patrick Drahi, principal actionnaire de SFR et à la tête de Libération, L’Express, BFM-TV, RMC, Martin Bouygues, PDG du groupe de construction et de télécomunication Bouygues, dont fait partie le groupe TF1. En plus, les principaux revenus de la presse proviennent de la publicité, et donc des grands groupes capitalistes.
Pour travailler dans ces rédactions, il ne faut donc pas fâcher les financeurs. Mieux même : il faut leur plaire. Et ça se ressent dans le choix des journalistes mis en avant, aussi appelé éditorialistes. Ce sont toujours les mêmes, qui passe d’un média à l’autre sans problème, grâce à leur docilité, leur idéologie mortifère, et leur défense des puissant·es. Deux exemples, pas avares pour défendre les puissants et dénoncer les plus faibles : Nicolas Demorand est notamment passé par Libération, Europe 1, RTL, France 5, Canal + et France inter. Natacha Polony est elle entre autres passée par France 2, Canal +, Europe 1, France inter et Marianne. Les autres journalistes doivent bien souvent garder leurs idées dans leur poche et s’adapter à la ligne éditoriale édictée.
Les puissant·es à la tête de ces médias les gèrent comme leurs autres entreprises : à coup de suppression d’emplois et de hausse de productivité. Cette industrialisation entraîne une uniformisation des sujets : tout le monde parle de la même chose, tout le monde interroge les mêmes personnes, tout le monde a les mêmes les mêmes angles et points de vue : réactionnaire et dominant. Et les personnes ne voulant pas s’adapter doivent partir, comme le montre ce qui s’est passé à Itélé (aujourd’hui CNews) en 2016, suite aux changements consécutif à rachat du groupe Canal+ par Bolloré : 100 journalistes sur 120 ont démissionné.
La concentration des médias aux mains d’une oligarchie, ainsi que la monopolisation de la parole par les éditorialistes, porte-voix de leur maître·sses, a pour conséquence une droitisation toujours plus poussée de la presse. A tel point que les élus du rassemblement national, constamment invités à s’exprimer par tous les médias, apparaissent presque comme les personnes les plus modérées sur les plateaux de CNews ou LCI.
En juin, à la sortie du confinement, les violences policières sont un sujet mondial. Les manifestations se multiplient partout aux Etats-Unis et un peu partout dans le monde, dont en France. Les journalistes sont obligés de s’emparer du sujet. Iels le font à leur manière, en faisant mine de s’interroger, et adoptent tou·tes le même angle : celui de la comparaison avec la situation étasunienne, pour en conclure qu’en France, ça n’a rien à voir. On a pu y voir une brèche, la suite nous a refroidi. Le terme ensauvagement s’installe au ministère de l’intérieur, qui ordonne une opération de police à Grenoble sur la base de vidéos extraites d’un clip de rap. Parce que l’insécurité n’augmente pas vraiment, il faut agir au nom du sentiment d’insécurité, véhiculé par les médias. La boucle est bouclée, le serpent se mord la queue.
Le champ médiatique est verrouillé. Il n’y a rien à attendre des grands médias, dont le seul but, en plus d’engranger les profits, est de justifier et faire perdurer le capitalisme et les autres systèmes de dominations.
1/ https://www.bastamag.net/Le-pouvoir-d-influence-delirant-des-dix-milliardaires-qui-possedent-la-presse (retour au texte)
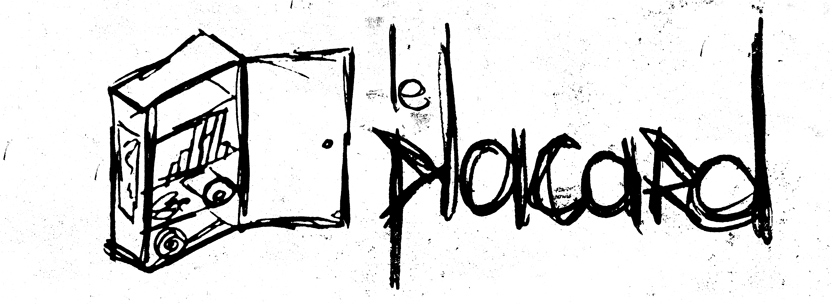
Le placard c’est un lieu à remplir d’outils pour déconstruire ce qui nous détruit et reconstruire selon d’autres envies. Un bric à brac pour tendre vers l’autonomie, échanger des savoirs et pratiques, se défendre contre ce monde pourri, créer, inventer… Dans ce lieu on tente d’être attentif·ves aux autres, de créer de nouvelles étagère pour y ranger plein de trucs plus que de reconstruire des murs entre nous.
Le placard est ouvert pour se rencontrer, apprendre les un.es des autres, faire évoluer les et ses idées.
Le placard est un lieu collectif, avec la volonté que sa gestion et son organisation le soit aussi. On tentera d’être moins opaque qu’une porte de placard. *C’est qui on ? C’est un nuage d’individus, à géométrie variable, regroupé pour faire vivre ce lieu et des idées, indépendant de tous partis, orga institutionnelle, petit·e chef·fe… et on souhaite le rester.
Si tu as envie de t’y investir, de proposer des choses la porte du placard est ouverte.
Ouvert le dimanche après-midi et parfois le mercredi
Au 23 route de paris à Poitiers
Le programme à jour sur https://leplacard.noblogs.org
Ce sont deux articles1 sortis à la fin du mois de juillet. Deux brefs rappels.
Le premier traite de la mort d’un ouvrier, mort en chutant d’un échafaudage d’un chantier de la SARL Rambault, à Châtellerault. Un échafaudage au garde-corps enlevé sous les ordres de la patronne. La même qui a ordonné aux autres employés présents de dissimuler son crime en remontant le garde-corps juste après “l’accident”. La patronne et son fils, dirigeant actuel de l’entreprise, recevront 2 mois de prison avec sursis et l’entreprise devra payer 14 500 euros d’amende pour homicide involontaire, défaut de formation à la sécurité et les échafaudages non conformes, ainsi que 10 000 euros à la mère de l’intérimaire et 2 000 euros aux autres membres de la famille.
Le second concerne un “accident” sur un chantier de l’entreprise Sterco à l’université de Poitiers. Suite à un démontage sans mode d’emploi, un contrepoids de plusieurs centaines de kilos se détache et tombe sur un travailleur : polytraumatisme, rate éclatée, ITT de 7 mois. 15 000 € d’amende pour l’entreprise Sterco, qui avait été jusqu’à licencier le salarié pour faute grave alors qu’il se trouvait sur son lit d’hôpital .
Les deux entreprises citées sont encore en activités.
Chaque année ce sont entre 500 et 550 personnes qui meurent d’un “accident” du travail. Mais ces accidents n’ont rien d’accidentel, ils sont le résultat des pressions des patrons à produire toujours plus, toujours plus vite. Des injonctions qui ne peuvent être satisfaite qu’en diminuant la sécurité. Ils mettent nos vies en jeu pour se remplir les poches.
A la fin de la journée, c’est nous qui finissons blessé·es, mutilé·es ou mort·es, pas nos chefs. Ce sont nos corps que le travail détruit.
Et si nous décidions de rendre un peu de ce qu’ils nous infligent, de reprendre ce qu’ils nous volent, ce serait nous que les tribunaux enverraient en prison. C’est pour nous enfermer que l’état dresse des prisons.
——
1/ https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/homicide-involontaire-oui-il-fallait-demander-pardon et https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/accident-du-travail-sur-un-chantier-de-l-universite-a-poitiers-15-000-d-amende-pour-la-societe (retour au texte)
L’État est partout, tout le temps. Par ses lois, il s’immisce dans nos vie, et décide pour nous. L’État régit parce qu’il saurait mieux que nous, parce qu’il serait garant de « l’intérêt général ».
C’est notamment le cas dans le domaine de la création, où toute œuvre créée est automatiquement soumise au droit d’auteur, sans que personne n’ait rien à faire, sans devoir ajouter de ©.
Le droit d’auteur se compose de deux types de droits. Le droit moral, qui reconnaît notamment à l’auteur la paternité de l’œuvre – merci, monde patriarcal d’utiliser des termes merdiques – et le respect de son intégrité, de manière obligatoire et pour toujours. Et les droits patrimoniaux, qui donne le monopole d’exploitation économique de l’œuvre, qui peut être donné ou vendu. Ce monopole s’arrête quand l’œuvre tombe dans le domaine public, qui permet de l’utiliser sans rien demander ni payer, 70 ans après la mort de son créateur·rices.
Voilà grossièrement résumé. Les effets maintenant. Vous faites un dessin. Vous le trouvez joli, et avez envie de le montrer au monde entier, alors vous le publiez sur internet, avec l’envie que les gens le voient, le partage, l’utilise, se le réapproprie. Et bien en l’état, c’est illégal. Pour l’utiliser, chaque personne devra obtenir votre autorisation. Disons que vous vous en foutez, du droit d’auteur, vous trouvez que c’est de la merde. Sauf qu’il a des effets, puisqu’il est possible que des personnes n’utilisent pas votre dessin par peur de « violer votre droit d’auteur ».
Depuis la fin des années 90, les majors des industries culturelles luttent contre ce qu’ils ont appelé « le piratage », c’est à dire l’échange d’oeuvres sur internet. Pour cela, ils ont lancé des actions en justice contre plein de gens, et pour les aider, les gouvernements du monde entier ont voté des lois restreignant les libertés, dont la célèbre HADOPI. Internet est alors passé d’un espace ouvert où le partage était la règle à un espace surveillé où le partage est un délit. En 2019 en France, une personne a été condamnée à deux mois de prison avec sursis et 1800€ d’amende pour avoir téléchargé 223 films sur emule. En 2015, un habitant de La Rochelle est condamné deux fois pour avoir créé une plateforme de partage à 2 millions d’euros d’amende et six mois de prison avec sursis puis à 3 millions d’euros d’amende et encore six mois de prison avec sursis.
Très peu de personnes gagnent de l’argent avec leurs créations, encore beaucoup moins en vivent. Le droit d’auteur est pourtant justifié par la rémunération des artistes, alors même qu’il permet surtout d’engraisser les majors. Que faire alors, puisque ne rien faire, c’est se soumettre au droit d’auteur ?
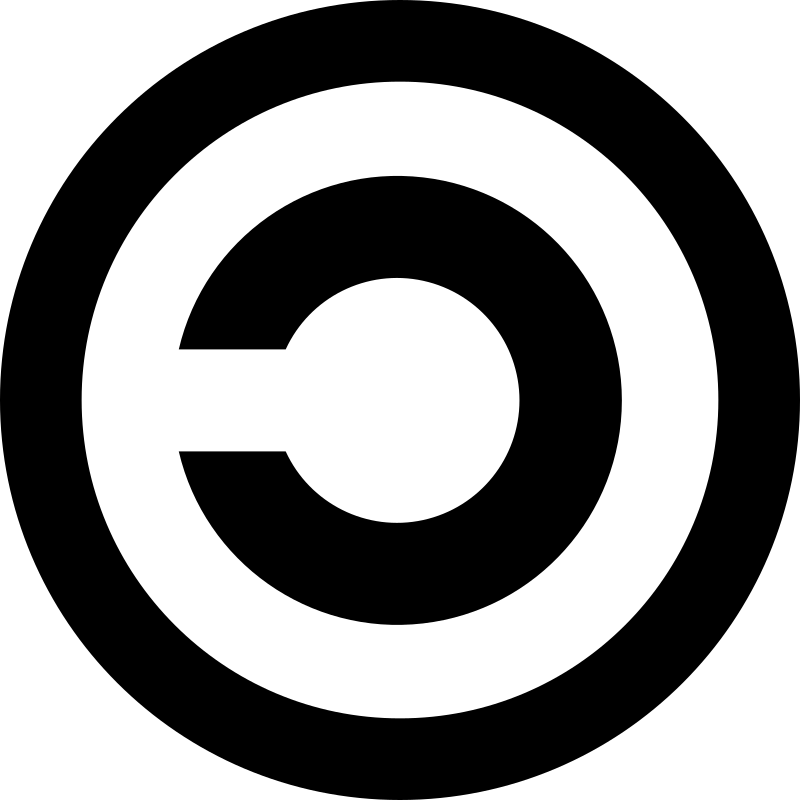
Libérer ses créations
Libérer ses œuvres passe par l’apposition d’une licence, qui est une autorisation donnée aux autres. En appliquant une licence à vos créations, vous expliquez clairement ce que vous acceptez qu’on fasse de vos œuvres. Pour contrer le concept de copyright, a été forgé celui de copyleft, par lequel un·e créateur·rice autorise l’utilisation, l’étude, la modification et la diffusion de ses œuvres, à condition que toutes œuvres dérivées soient partagées dans les mêmes conditions.
Pour simplifier les choses, des licences existent : on peut citer la licence art libre (licence copyleft), ainsi que l’ensemble des licences creative commons. Ces dernières sont au nombre de six, et sont la combinaison de quatre variables : attribution (citer l’auteur·rice), non commercial (interdiction de faire commerce de l’œuvre), pas d’œuvres dérivées et partage dans les mêmes conditions. Pour utiliser ces licences, il suffit d’apposer un logo et un petit texte précisant la licence utilisée dans l’œuvre ou à côté. Par exemple pour votre dessin, vous pouvez ajouter le logo de la licence dans un coin de celui-ci, ou bien sur la page où vous partagez ce dessin.
Il est aussi possible de créer votre propre licence, en précisant ce que vous acceptez qu’on fasse de vos œuvres. C’est ce que nous avons fait dans ce torchon, avec la Lic’lance Libre (visible en dernière page). Et rien ne vous empêche, si une personne utilise vos œuvres d’une manière qui vous dérange, d’aller lui demander d’arrêter.
Libérer ses œuvres grâce à l’apposition d’une licence, ça permet de passer de « vous ne pouvez rien faire de mes œuvres sans mon autorisation » à « voilà ce que vous pouvez faire de mes œuvres ». Ca permet le partage sur des bases claires. Et ça vous redonne du pouvoir, aussi bien en tant que créateur·rice qu’en tant qu’utilisateur·rice.
C’est le 9 septembre que le tour de france est passé à poitiers. Un spectacle sans critiques tant l’unanimité semble de mise, du côté des politiciens de Poitiers Collectif comme parmi les journalistes du cru. Il y en a pourtant des choses à dire sur la petite entreprise de Marie-Odile Amaury et sa famille (452e fortune de France).
Tout d’abord ce spectacle est loin d’être gratuit puisque c’est plus de 750 000 € qui sont déboursés pour satisfaire aux exigences de l’entreprise qui gère le tour de France. Un coût qui représente plus de la moitié du budget prévisionnel en travaux de voirie et stationnement du plan vélo pour la période 2016-2020. Des travaux qui peuvent aller jusqu’à l’absurde, par exemple en démontant des aménagements routiers puis en les reconstruisant une fois le spectacle terminé, comme pour le rond point de l’avenue de Nantes. Cela aura pu être des vélos pour toustes, des pistes cyclables pour les usages de tous les jours, ce sera du goudron luisant pour l’unique passage de sportifs et leur cour de motos, voitures et ses kilomètres de camions publicitaires.
Le but de tout ce spectacle est avant tout de vendre des heures et des heures de publicité. Les cyclistes sont ainsi des panneaux publicitaires ambulants et les noms des équipes sont composés de marques. Ces noms d’entreprises sont martelés sans cesse durant toute la durée de la compétition. Conduisant à oublier que ce sont ces entreprises. Groupama-Française des jeux, ce n’est pas seulement une équipe, ce sont deux entreprises et marques s’enrichissant sur les plus pauvres. Groupama (assurance-banque) arnaque notamment ses clients à travers des assurances obsèques. Quand aux jeux de hasard, ils ne font qu’appauvrir celleux qui y jouent.
Après avoir démontré leur virilité dans cette absurde compétition, les pathétiques champions du jour, pourront recevoir leur « dû » décerné par des femmes réduites à satisfaire les fragiles égos masculins ou à distribuer d’inutiles et polluants gadgets publicitaires. C’est la seule place accordée aux femmes sur le tour de France.
Ce que vend le tour de france, ce n’est pas le vélo populaire mais une pratique bourgeoise élevée au rang de divertissement. Le vélo, à la pointe de la technologie, devient un objet de luxe. Rien à voir avec un usage quotidien comme moyen de déplacement. Le passage du tour de france, présenté comme une vitrine du vélo, aura servi surtout à refaire les routes servant aux voitures. Sans diminution de la place prise par la voiture, d’autres modes de déplacements ne peuvent pas se développer, même pas le vélo.
